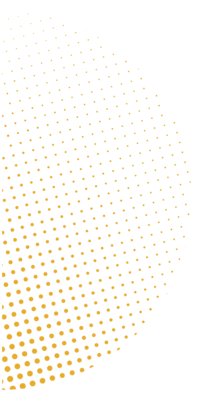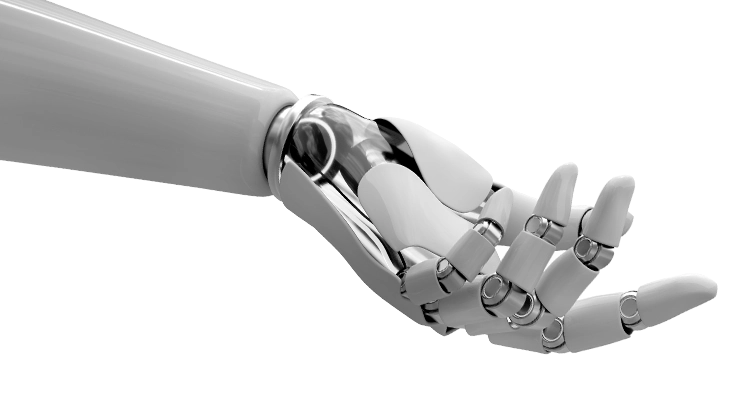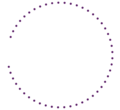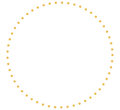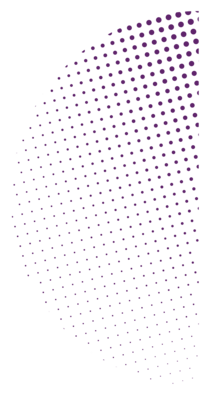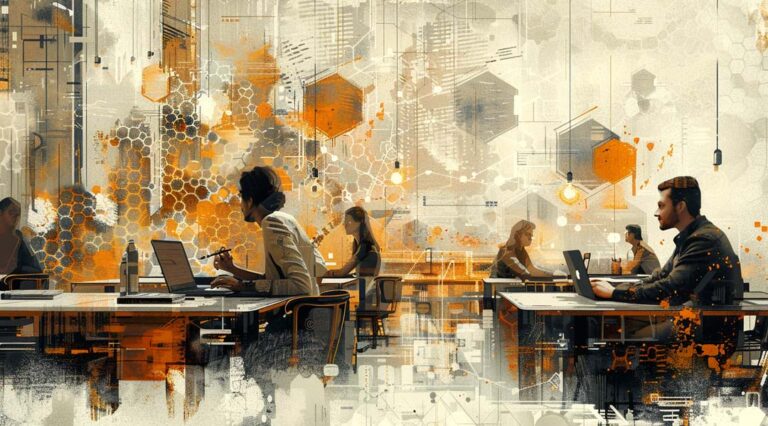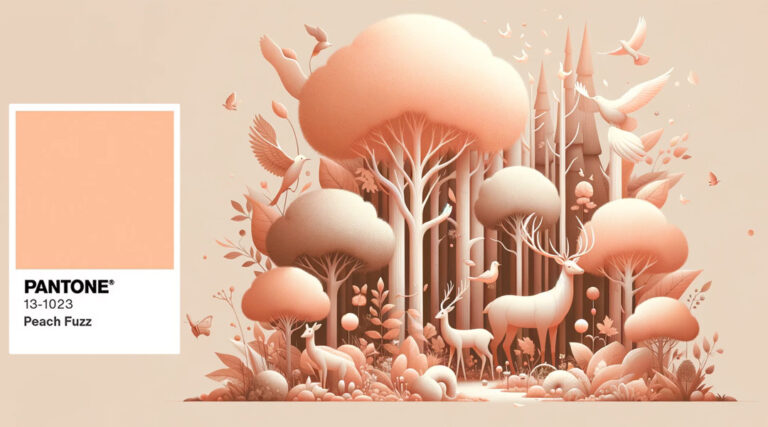Graphiste à l’ère de l’IA : survivre, s’inventer ou s’effacer ?
Quelque chose a changé. Ce n’est pas qu’un effet de mode ou un nouveau plugin à tester un dimanche matin. C’est plus vaste. Plus souterrain.
L’intelligence artificielle est entrée dans l’atelier.
Et elle ne frappe pas, ne demande pas si elle peut s’asseoir à côté de nous. Elle génère, elle compile, elle propose.
En quelques secondes, elle fabrique ce que l’on met des heures à penser. Et parfois, c’est joli.
Alors voilà : le métier de graphiste à l’ère de l’IA se redéfinit, lentement mais sûrement. On lit tout et son contraire. Que notre métier va disparaître. Qu’il sera démultiplié. Qu’il doit se battre, ou s’adapter. En vérité, on est plutôt entre les deux : ni menacé, ni sauvé, mais transformé.
Ce qui est certain, c’est que les règles du jeu changent. Et que notre rapport à la création graphique, à la propriété intellectuelle, à l’authenticité visuelle, aussi.
Alors, faut-il avoir peur ? Se battre ? Se fondre dans le flux ? Ou, plus subtilement, retrouver ce qui, en nous, reste fondamentalement humain, malgré l’algorithme ?
Je vous propose une promenade (critique mais pas cynique) dans cette contrée mouvante : là où le graphisme rencontre l’intelligence artificielle. Spoiler : on y croise des clones de Totoro, des procès de droits d’auteur et une petite révolution du métier.
L’IA qui rêve en Ghibli : hommage ou pillage ?
Sur Instagram, les images IA “façon Ghibli” ont envahi les feed. Des ruelles fleuries, des ciels laiteux, une petite brume douce comme une nappe du dimanche. C’est beau, c’est envoûtant, c’est… étrange. Car derrière la prouesse technique, il manque quelque chose. L’intuition ? La maladresse ? L’âme, peut-être.
Hayao Miyazaki, grand alchimiste du sensible, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, ces images sont une “insulte à la vie”. Et non, ce n’est pas une posture de vieux maître grincheux. C’est un cri. Et on le comprend. Car ces images, elles empruntent tout sans rien ressentir. Pas de souffle, pas de mémoire, pas d’intention.
L’IA fait du style, pas du sens.
Exemple :
Tapez dans Midjourney : “Ghibli style cityscape at night, glowing lights, soft atmosphere”. Résultat : magnifique, mais interchangeable. C’est un collage sous stéroïdes, une coquille vide habillée en poésie. L’IA pioche, assemble, recrée — mais sans savoir pourquoi. Là où un illustrateur cherche, doute, rate, recommence… l’IA répète. C’est fluide, mais creux.
Analyse créative :
Le graphiste IA ne peut se contenter de copier. Son rôle n’est pas de produire des images qui plaisent, mais de poser des choix, d’ouvrir des pistes. Il est dans l’arrière-plan de la création : les hésitations, les références croisées, l’émotion qu’on met dans une courbe. C’est l’intention qui fait l’œuvre. Et cette intention-là, aucune machine ne peut encore l’imiter.
Les « starter packs » IA : des vies en kit, livrées avec typo
Autre tendance : les fameuses planches “starter pack”, générées en deux clics. Un métier = une palette d’objets. Une ambiance. Un cliché. On dirait un moodboard fabriqué par un algorithme styliste : tote bag, lunettes rondes, carnet Moleskine, et une plante en pot.
Graphiste en 2025 ? MacBook Pro, t‑shirt noir, livre de typographie suisse et café filtre. Check.
C’est propre, c’est cohérent, mais désespérément uniforme.
C’est drôle cinq minutes. Mais derrière le clin d’œil, ça dit quelque chose d’ennuyeux : une créativité qui s’aplatit. Qui devient reconnaissable. Prévisible. Optimisée.
Or, la création ne naît pas de l’efficacité. Elle vient du frottement. Du hasard. Du détail incongru. Et l’IA, elle, ne produit que ce qu’elle a déjà vu.
À force de faire de la synthèse, on finit par tuer l’accident.
Exemple :
Une IA produit vingt déclinaisons de “graphiste lifestyle” pour un post LinkedIn. Toutes jolies. Aucune vivante.
Analyse créative :
À force de chercher l’image parfaite, on oublie l’image juste. La création visuelle, c’est aussi une histoire de rupture. D’accident heureux. De contraste qui choque l’œil avant de ravir l’esprit. Du hasard. Du détail incongru. Et l’IA, elle, ne produit que ce qu’elle a déjà vu. À nous de casser ses recettes.
Ces starter packs lisses comme du PVC oublient que le graphiste est d’abord un chercheur, pas un décorateur. Il pose des questions visuelles. Et parfois, il dérange. Tant mieux.
Droits d’auteur à l’ère de l’IA : qui signe l’image ?
Ici, on quitte le poétique pour le juridique. Moins sexy, mais essentiel. Car l’IA, pour créer, a besoin de matières premières. Et ces matières, ce sont souvent nos images à nous. Derrière les images générées, une question se pose, plus épineuse : celle du droit d’auteur.
Des artistes ont découvert leurs œuvres dans des bases de données d’entraînement. Sans accord, sans crédit. Juste digérées, recombinées, puis recrachées en douce. Certaines plaintes ont été déposées. Et peu à peu, la justice commence à trancher : une œuvre faite uniquement par une IA ne peut pas être protégée. Pas assez humaine, tout simplement.
Quand une IA apprend avec nos dessins, sans nous le dire, est-ce toujours de l’apprentissage ou déjà du vol ?
Exemple :
L’artiste Karla Ortiz a vu ses illustrations reprises dans les datasets d’entraînement de plusieurs IA. Sans son accord. Sans rémunération. Sans même un remerciement. Résultat : un procès. Et une prise de conscience.
Analyse :
Le droit d’auteur à l’ère de l’IA est un territoire flou, mais il va falloir le cartographier. Pour que le travail du graphiste ne devienne pas une ressource gratuite pour générer du “contenu”.
Créer, c’est produire de la valeur. Cette valeur mérite d’être protégée, surtout face à des outils aussi puissants. Dans ce contexte, le rôle du graphiste redevient central. C’est lui, l’auteur. Celui qui décide. Celui qui assume une vision. L’IA peut l’aider, mais elle ne peut pas signer à sa place.
Le graphiste augmenté : plus cerveau, moins outil
Alors, que fait-on avec cette IA qui dessine plus vite que son ombre ? Et si on arrêtait de trembler ? Et si on apprenait à cohabiter ?
L’IA peut être un formidable compagnon de jeu, à condition qu’on ne lui donne pas les clés du studio. Elle exécute vite. Nous, on pense lentement. C’est un bon duo, à condition de garder les rôles clairs.
Oui, l’IA peut prototyper une idée en quelques secondes. Explorer des variations qu’on n’aurait pas osées. Automatiser des tâches ingrates : redimensionner, générer des déclinaisons, tester des palettes.. Mais elle ne remplace pas l’œil, ni le goût, ni l’intuition.
Un bon visuel ne vient pas d’un bon algorithme. Il vient d’une intention claire.
Exemple :
Un graphiste utilise une IA pour générer des variantes de mise en page. Il sélectionne, réinterprète, modifie. À la fin, l’image finale n’est pas celle de l’IA. C’est la sienne, enrichie par un détour algorithmique. Le graphiste reste chef d’orchestre. L’IA, elle, n’est qu’un pupitre.
Analyse :
Ce qui compte, c’est le rôle que l’on choisit. Si on laisse l’IA penser à notre place, elle le fera — sans émotion. Mais si on l’utilise comme un outil, un complice maladroit mais rapide, alors on gagne du temps pour l’essentiel : le sens, l’idée, la narration visuelle.
Et cela, soyons honnêtes, c’est une belle opportunité. Car ce qui compte, ce n’est pas le nombre de visuels qu’on peut produire. C’est la qualité de ceux qu’on choisit de montrer.
Et c’est là que le métier se redessine. Moins dans l’exécution, plus dans la direction. Moins dans le faire, plus dans le penser. Le graphiste de demain sera sans doute plus auteur, plus stratège, plus conteur visuel.
L’intelligence artificielle ne va pas tuer notre métier. Mais elle nous pousse à poser de nouvelles questions. Qu’est-ce que créer ? Qu’est-ce qu’un style ? Qu’est-ce qu’un auteur ? Elle va nous forcer à muter. À nous redéfinir. À nous interroger. Et ça, au fond, c’est une bonne chose.
Les graphistes ne sont pas des machines à produire du “beau”. Ils sont des penseurs visuels, des conteurs d’émotions. Tant qu’il y aura des histoires à dessiner, des silences à typographier, des signes à faire parler, le métier vivra. Mais peut-être autrement.
Face à ces mutations, il ne s’agit pas de fuir. Ni de se soumettre. Il s’agit d’affirmer ce qui nous rend singuliers. Un regard. Une émotion. Une intention graphique que l’IA ne peut pas deviner.
Travailler avec l’IA, oui. Mais pas en pilote automatique. En conscience. En vigilance. En artistes. Sans perdre notre voix, nos doutes, nos fulgurances. Sans sacrifier la surprise au confort. Sans oublier que chaque image est une prise de parole.
Le futur du graphisme ne se joue pas dans la vitesse, mais dans la justesse. Et ça, aucune machine ne pourra jamais l’imiter sans nous.
Au PATIO NUMÉRIQUE, quelle est
la place de l’IA dans la création ?
En quoi l’usage de l’IA améliore-t-il la rapidité, la qualité ou la pertinence des créations ?
Quelle valeur accordons-nous au regard artistique et humain dans un projet créatif ?
L’IA est-elle utilisée pour enrichir la direction artistique ou simplement pour générer du contenu générique ?
Comment évaluer la qualité d’un visuel dans un monde où tout peut être généré en 10 secondes ?
Si vous avez d’autres questions… Contactez-nous !

Cet article a été généré par ChatGPT, en plusieurs étapes que nous allons détailler ici.
Dans cet article, ALICE interroge son métier face à l’intelligence artificielle : quel avenir pour les graphistes dans un monde où l’intelligence artificielle peut générer des images en quelques secondes ? Ce sujet soulève une tension (ici : créativité vs automatisation), touche un public défini (les créatif·ves, graphistes, artistes visuels) et laisse de la place pour une voix subjective. L’idée n’est pas de “faire un point complet sur l’IA”, mais d’explorer ce que ça fait d’être graphiste aujourd’hui, au cœur de cette mutation.
STEP 1 : Poser le sujet en donnant des instructions claires : domaine / objectif / intention / ton / cible
Tu es mon assistant pour la rédaction d'un article de blog sur l'avenir des graphistes face à l’intelligence artificielle. Ton objectif est de m'aider à rédiger un article dans le style rédactionnel d'ALICE, défini au préalable, avec l'intention de traiter ce sujet, déjà très débattu mais de manière souvent technico-froide, en lui injectant une voix, une vision, une position. Elle doit incarner chaque idée avec un exemple, rendant l'article non seulement instructif mais aussi agréable à lire. Une observation concrète, un décryptage, une position assumée. Cela permet d'ancrer le propos dans le réel, tout en gardant un ton éditorial subjectif et sensible.STEP 2 : Demander des idées de titre et définir les mots-clés pour le SEO
D'abord, donne-moi une liste de 10 mots-clés (longue et courte traîne) pertinents pour mon article, dans le cadre d'une optimisation SEO, puis fais-moi 5 propositions attrayantes pour le titre incluant ces mots-clés.
Le mot-clé principal est intégré au moins 10 fois, dans les titres, intertitres, et naturellement dans le texte. es secondaires sont répartis sans forcer, en lien avec les idées traitées. Aucune sur-optimisation : le texte doit rester fluide, lisible, organique.STEP 3 : Définir la structure de l’article (et la remanier…)
Fais-moi un plan détaillé de l'article, avec la structure suivante : Introduction (250 mots), 4 parties (850 mots), Conclusion (250 mots). Balises : titres avec balises H2 et H3, contenant des mots-clés principaux ou synonymes. Le plan doit au moins détailler les points clés à développer.STEP 4 : Lancer la rédaction de l’article
Rédige l'article, de 1200 mots minimum, dans le style rédactionnel d'ALICE que nous avons défini ensemble, et selon le plan validé.
Utilise un langage naturel et varié, des expressions et un vocabulaire diversifiés pour rendre l'article plus humain et naturel.
Intègre des références culturelles, artistiques et littéraires pour enrichir l'article.
Utilise un style narratif qui évoque des images poétiques et engageantes, pour rendre l'article non seulement instructif mais aussi agréable à lire.
Rythme narratif progressif : du constat ➝ au conflit ➝ à la perspective.
Observation concrète ➝ décryptage ➝ position assumée.
Dispositif : ne pas adopter un ton polémique ou binaire.
L'article doit avoir un positionnement clair mais nuancé, une voix humaine et incarnée, des exemples concrets et situations réelles, mais aussi des métaphores visuelles et poétiques.
L’article doit contenir les mots-clefs principaux ainsi que ses synonymes. Cet article doit-être optimisé pour les moteurs de recherches.
Crée une méta-description de 50 mots maximum et ajoute-la à la fin de l’article.Bien entendu, tout au long de ces étapes, l’intervention humaine est primordiale :
il faut reformuler et préciser chaque demande si nécessaire, ajouter des détails et des spécifications, réviser, ajuster, relire, modifier…
L’image a été générée par MIDJOURNEY avec le prompt suivant :
A dreamy studio scene featuring an artist in soft focus, seated among analog tools - sketchpads, easels, ink pots, vintage cameras - while AI-generated images hover mid-air in translucent layers. The environment is pastel-toned, with pinks, lavenders, mint green, and baby blue hues. Background is foggy, surreal. Diffused natural light from ceiling windows. Created Using: pastel blending techniques, Nikon D810 shallow DOF, gouache textures, Procreate for compositing, dreamcore influence, analog lens flares, paper grain overlay, softbox lighting --ar 16:9